L’haltérophilie est un sport olympique depuis 1896 qui consiste à soulever les charges les plus lourdes possibles à l’aide d’une barre olympiques. Deux mouvements constituent la discipline : l’épaulé jeté et l’arraché.
UN PEU D’HISTOIRE
- Antiquité
Les récits de la mythologie et de l’histoire ancienne contiennent une foule de légendes dans lesquelles la force musculaire joue un rôle prépondérant. Les deux premiers athlètes dont les récits nous rappellent les hauts faits sont SAMSON, dont parle la bible et HERCULE que nous retrouvons dans la mythologie romaine. Nous retrouvons chez les Grecs l’amour très intense de la force musculaire avec MILON DE CROTONNE.
A l’origine il semblerait que les premiers haltérophiles étaient des sauteurs. En effet, certaines sculptures représentent des athlètes tenant en main, bras fléchis des sortes d’haltères en pierre de forme géométrique. Les haltères en pierre pesaient environ 25 kilos. Ce qui paraît formidable, c’est que le diamètre était d’environ 35 cm, le maniement de ces engins avait pour but, paraît-il de donner plus d’élan aux sauteurs.
- Moyen-Age et Renaissance
Les hommes forts sont légion à cette époque. Tous les chevaliers s’illustrèrent par de nombreux tours de force. Il fallait être déjà d’une force supérieure pour combattre avec une si lourde armure, de plus, le maniement des armes de cette époque n’était simple.
PEPIN LE BREF BAYARD, DUGUESLIN, GODEFROY DE BOUILLON qui tous furent d’une force stupéfiante. Cette période était plutôt riche en tours de force mais il ne reste pas de trace du sport haltérophile.
Les exercices de levers étaient bien souvent exécutés à l’occasion de paris. Dans la littérature Française, il semble que ce soit Rabelais qui utilisa en premier le mot « haltère ». Au siècle de Rabelais, les troupes de forains, bateleurs, hercules, s’exhibaient déjà sur les places publiques dans des tours d’adresse et de force. Il est donc possible que les haltères impressionnants cités par Rabelais aient été inspirés par de tels spectacles.
- Le XIXe siècle
Au début du siècle, Charles ROUSSELLE fut surnommé l’Hercule du Nord. Une histoire plus ou moins vraie nous raconte qu’un jour pour indiquer le chemin à un passant, il saisit sa charrue par le manche d’une seule main et la souleva comme il eut fait d’un jouet. Sa statue peut être admirée encore au jardin des Tuileries dans la pose de l’Hercule terrassant l’Hydre. Ce fut également un des plus grands lutteurs de son époque (1827).
Le travail en placarde. Le premier homme qui eut l’idée de travailler en public les poids et haltères fut un nommé Jean BROYASSE qui naquit à Lyon en 1798.
Il tenait ses haltères tenait d’un Allemand nommé STUCKER fixé en France depuis l’âge de 20 ans. BROYASSE s’engagea dans un cirque avant de travailler seul sur les places publiques.
Apparaît à la même époque Hippolyte TRIAT (1812-1881), il est le véritable précurseur de l’haltérophilie. Orphelin à quatre ans, enlevé par des bohémiens à six ans, il fut d’abord danseur de corde, puis dès l’âge de treize ans, il présentait en compagnie d’un Espagnol et de ses deux fils un numéro de lever de poids. A Bruxelles, il créa un gymnase qu’il dirigea pendant sept ans. Agé de 35 ans, il fit aménager une magnifique salle, à Paris. Il décéda à l’âge de 69 ans.
Véritable athlète, TRIAT possède à l’âge de 42 ans, selon le témoignage du docteur Cassel les mensurations suivantes : taille 179 cm, poids 95 kg, poitrine 124 cm, bras 41 cm, ceinture 83 cm, cuisse 73 cm.
Ses principales performances étaient impressionnantes :
– Lever d’un seul temps avec les 2 bras (arraché) : 101 kg
– Soulevé sur le dos, mains appuyées sur un tréteau : plus de 1 000 kg
– En équilibre sur une barre, sur un seul pied, il levait 2 haltères de 45 kg chacun
– Epaulé jeté du bras droit : 91 kg
– Epaulé jeté du bras gauche : 84 kg
Malgré l’impulsion donnée par TRIAT, l’haltérophilie ne s’implante pas immédiatement en France. Alors que le goût de l’effort physique naît dans notre pays de la pratique de la bicyclette, nouveau moyen de locomotion rapide et économique, alors que la gymnastique aux agrès s’organise.
Les débuts du sport haltérophile sont longs et laborieux. Pratiqué le plus souvent dans des arrière-salles de cafés et dans quelques gymnases, le lever de poids reste encore l’apanage de quelques professionnels de la force.
Vers 1880, les premières associations missent en Allemagne, à Hambourg, Cologne, Leipzig, Francfort, Duisbourg et Munich.
En France, les hommes forts s’entraînent dans quelques gymnases, comme celui d’Eugène PAZ, mais le premier essai d’organisation sérieuse revint aux associations de Lille et de Roubaix qui vers 1890 fondent la Fédération athlétique du Nord.
Après plusieurs années de discussions et de tâtonnements, une nomenclature des mouvements est établie :
– les développés, arrachés, épaulés-jetés à un et à deux bras
– le dévissé d’un bras
– la volée d’un bras
– le bras tendu
Des règlements furent créés de toutes pièces qui donnaient à chaque exercice un nom, un règlement propre. Des records furent établis distinctement pour les amateurs et les professionnels qui étaient très différents.
DESBONNET fonda les dynamométreurs (ou arbitres) contrôlant les performances au dynamomètre de Régnier.
C’est du Nord qu’est venue l’amour de la force. Le pays des hommes forts, comme il fut souvent appelé, se devait de fournir outre les athlètes, les rudiments du code de la force.
En 1883, DESBONNET fonda au sein de la société de gymnastique “la concorde” une section de poids et haltères, successivement d’autres sociétés (la jeunesse lilloise, la Française…) créèrent des sections analogues. En 1888, il rédigeait les règlements types dont certains sont encore d’actualité.
Enfin en 1894, vers Noël fut organisé toujours par le même homme le premier championnat international auquel prirent part Français, Belges, Hollandais. Il eut lieu en Belgique à Mouscron.
Aux premiers jeux olympiques de l’ère moderne à Athènes en 1896 l’haltérophilie figurait au programme parmi les disciplines sportives optionnelles mais le baron Pierre DE COUBERTIN à qui revient le mérite de la rénovation des “jeux ” après 1503 ans d’interruption ignora l’inscription de ce sport au programme olympique.
- Le XXe siècle
A chaque nouvelle organisation internationale, le choix, le nombre ou l’exécution des mouvements étaient différents, en 1902 aux championnats du monde, à Londres, le programme ne comprenait pas moins de onze mouvements de même que l’année suivante à Paris. Le statuaire athlète Alexandre MASPOLI se tailla un succès formidable à Londres en améliorant tous les records existants et s’affirmant supérieur aux Anglais.
Déjà avant 1900, Edmond DESBONNET avait compris la nécessité d’une organisation internationale afin de planifier, de réglementer cette discipline. Il créa alors l’Haltérophile Club de Paris appelé plus tard “haltérophile Club de France ” qui avait pour ambition de réunir les principaux dirigeants du monde entier. DESBONNET tenta alors de réunir Russes, Italiens, Anglais, Argentins, Canadiens, Autrichiens, Français, sans succès. Pourtant, l’H.C.F. assura, en France, l’organisation d’épreuves nationales et internationales. Le premier championnat de France, eut lieu en 1901, au cirque Mollier.
En 1907 deux listes de records du monde (amateurs et professionnels) publiées par DESBONNET ne comportaient pas moins de 22 mouvements chacune. Tous les records étaient détenus par des Français, quelques Belges et des Suisses. Les palmarès aberrants, mettaient en évidence l’absence d’un organisme international, car pendant cette même période, l’haltérophilie connut un prodigieux essor en Allemagne et en Autriche.
La ville de Vienne produisait de véritables colosses. En 1905, tandis que MASPOLI remportait le championnat de France avec, entre autres performances, 130 kg au jeté, STEINBACH en Autriche, battait le record du développé en haltères séparés, avec 135 kg Jusqu’à la première guerre mondiale, les compétitions se multiplièrent dans les pays germaniques, alors qu’en France, depuis le départ de DESBONNET de l’H.C.F., l’activité ne dépassait pas le niveau des clubs, rares étaient les compétitions officielles.
Le 23 mars 1914 que Jules ROSSET, BUISSON (ancien champion des légers), HEILES (ex-recordman du Monde) et BOURDONNAY fondèrent la Fédération Française de Poids et Haltères à Paris.
Ancien lutteur, bon haltérophile, Jules ROSSET était un vrai sportif. Il se révéla excellent dirigeant : La F.F.C.H. avait encore peu fonctionné lorsque survint la guerre. A ce moment existaient toujours les tableaux de records (Français -Mondiaux) établis par l’H.C.F. la nouvelle Fédération les adopta sans y rien changer, pas plus qu’aux règlements en vigueur. Une entente ou une fusion devenait donc nécessaire. Elle ne se réalise qu’après la guerre et à partir de 1919, la F.F.P.H., en plein accord avec l’ancien H.C.F., qui lui avait transmis tous ses documents, records et arbitres, resta seule en France pour présider aux destinées du sport haltérophile.
La même année Jules Rosset est chargé par M. Frantz Reichel de s’occuper des Jeux interalliés et comme dirigeant fait admettre les poids et haltères aux jeux olympiques d’Anvers en 1920 et fonda alors, la Fédération Internationale haltérophile dont il fut le président jusqu’en 1952. Il décédait le 18 mars 1973.
En 1920, aux jeux olympiques, 14 Nations participèrent aux épreuves d’haltérophilie. La France eut deux champions olympiques : GANCE en moyen et CADINE en mi-lourd.
Aux championnats du Monde en 1922 à Reval, la France remporta 2 titres. Roger FRANÇOIS en moyen.
En 1924 aux J.O. qui furent organisés à PARIS, DECOTTIGNIES en léger et RIGOULOT en mi-lourd remportèrent la palme suprême. Jules ROSSET après les jeux de Paris, obtint l’inscription définitive de l’haltérophilie aux J.O., à la condition que “les exercices imposés ” se limitent aux trois mouvements à deux bras
La Fédération Internationale où l’influence française sera prédominante avec ROSSET, puis GOULEAU et DAME jusqu’après 1950, organisera quelques championnats du Monde et d’Europe pendant la période 1920-1939. Elle se structurera plus solidement à partir de 1946, ou désormais chaque année voit l’organisation d’un championnat du Monde et d’Europe chaque année voit des affiliations nouvelles.
Après ces débuts difficiles, hésitants, l’haltérophilie s’est donc solidement organisée, elle s’est hissée au niveau des grandes disciplines sportives. Tous les fervents du sport haltérophile doivent rendre hommage aux pionniers, aux initiateurs, aux grands dirigeants, sans oublier les athlètes les plus prestigieux qui par leurs performances et leur personnalité ont attiré l’attention de leurs contemporains et ont suscité des vocations (deux exemples) :
- Le Lyonnais MASPOLI : il était sculpteur de talent et particulièrement brillant dans les exercices de détente, il débuta à l’âge de 12 ans par la gymnastique. En 1898 à Vienne il est sacré champion du Monde et recordman amateur, En 1900, il est champion aux premiers championnats de France amateur à Paris (cirque Molière). De 1903 à 1905 il est plusieurs fois champion dans diverses épreuves nationales et internationales. En 1906, à Athènes il représente la France aux “jeux Olympiques ” (non reconnus) il terminera 3ème aux poids et haltères et 7ème au saut en longueur sans élan avec 2,90 m. Il est décédé en 1943 et fut président du Lyonnais.
- Louis VASSEUR, né à Roubaix dans le Nord le 24 janvier 1885 arrache le samedi 5 octobre 1912 au gymnase Rosset à Ménilmontant, à droite le poids formidable de 100 kg (en barre), c’est la 1ère fois que cet exploit a lieu officiellement. Il pèse alors 97 kg. Il fut la révélation du championnat international de Lille en 1906. En 1910, il bat le record de Maspoli (135,5 kg) avec 136,5 kg au jeté à 2 bras et réussira plus tard 142,5 kg. En 1913 il arrache 116 kg à 2 bras record du monde. Il fut aussi recordman de France amateur du lancer de poids (7,257 kg) avec 12,78 m en 1909, et du lancer du disque avec 33,20 m en 1906.
Voici quelques personnalités reconnues au sein de l’haltérophilie française :
- François VINCENT né le 10 avril 1936. 5é aux jeux olympiques de Rome en 1960. Record personnel 435 kg au total (3 mouvements).
- Jean-Paul FOULETIER, athlète, étudiant en médecine dans les années 60, a valorisé l’image de l’haltérophilie auprès des médias. Il fut le premier Français à totaliser 500 kg aux 3 mouvements, c’est le 16 décembre 1962 qu’il améliora ses premiers records de France chez les lourds avec 129 kg à l’arraché et 164 kg à l’épaulé-jeté (les anciens appartenaient à Jean DEBUF avec 128,5 et 163 kg), fut sélectionné aux jeux olympiques de Montréal en 1968. Ses records 180 kg au développé, 157,5 kg à l’arraché, 195 kg à l’épaulé-jeté.
- Bruno LEBRUN né le 24 décembre 1956 à Houilles, 1,62 m pour 56 kg puis 60 kg 9è aux championnats du monde en 1978 à Gettysburg avec 230 kg en 56 kg, 12è aux championnats du monde 1979 à Salonique participa aux jeux de Moscou en 80.
- Bruno MAÏER né le 14 juillet 1961 à Roubaix, fils de Rolf MAÏER, recordman de France en 60 kg senior à l’arraché avec 120,5 kg
- Vencelas DABAYA né le 28 avril 1981 à Kumba, au Cameroun, 5ème aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes (sous les couleurs du Cameroun), 2ème aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin (sous les couleurs de la France), champion d’Europe en moins de 69kg et champion du monde en 2006 à Santo Domingo, 3 médailles de bronze aux championnats du monde d’haltérophilie à Doha et 10 fois champion de France.
- LES TECHNIQUES
- Epaulé jeté (ou clean and jerk)
L’épaulé jeté (ou clean and jerk) est l’un des deux mouvements d’haltérophilie, il permet d’utiliser généralement 20% de poids en plus que l’arraché.
L’épaulé jeté se décompose en deux mouvements, l’épaulé (ou clean), qui consiste à tirer la barre depuis le sol jusqu’aux épaules, ainsi que le jeté (ou jerk) qui consiste à pousser violemment la barre au-dessus de se tâte, bras tendus. L’épaulé jeté se compose d’un premier tirage (tirage bas), un second tirage (tirage haut), une chute (passage en flexion profonde sous la barre), une remontée.
- L’arraché (ou snatch)
L’arraché (ou snatch), est l’autre mouvement de l’haltérophilie, il est souvent considéré comme le mouvement le plus complexe de la discipline. L’arraché se décompose en plusieurs étape : un premier tirage (tirage bas), un second tirage (tirage haut), une chute (passage en flexion) et une remontée.
- EQUIPEMENT
La barre d’haltérophilie mesure 2200mm et pèse 20 kg pour les hommes, 2010mm et 15kg pour les femmes. Sur la partie centrale de la barre, un moletage rend la barre rugueuse et facilite la prise. Sur chaque côté, on y glisse des disques qui sont maintenus par un collier pesant 2.5kg
Les disques sont en métal et recouvert de caoutchouc pour amortir les chocs.
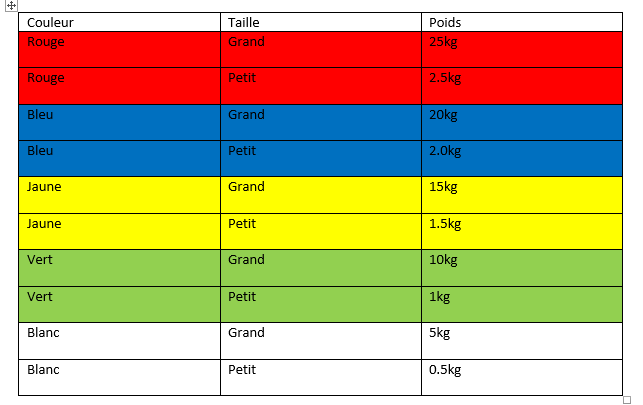
Des disques de 0.5 à 2kg ont été ajoutés depuis que la règle du « 1.0kg » prévaut (depuis 2005) lors des compétitions : la charge doit être un multiple de 1.0kg
Le plateau de travail mesure 4x4m
L’haltérophile porte des chaussures spéciales, rigides et stables. Elles comportent un talon de quelques centimètres. En compétition, il doit porter un maillot réglementaire. Il peut porter une ceinture de force s’il le souhaite.
SOURCES :
- Wikipédia
- LECHEVALIER.R, La nouvelle Haltérophilie
- MALLET.E, Historique sur l’Haltérophilie